L’ascension de l’Iran comme puissance hégémonique au Moyen-Orient depuis 2003
Introduction :
« Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera », aurait déclaré Napoléon en 1816. Cette phrase prophétique aurait pu également s’appliquer à l’Iran, tant le retour en force de cette puissance sur la scène internationale semble bouleverser l’équilibre géopolitique mondial.
L’Iran, en forme longue République islamique d’Iran, revendique une histoire pluri-millénaire. De fait, la fondation de l’Empire perse par Cyrus II le Grand remonte à 559 avant JC. Durant la majeure partie de son histoire, la Perse est dirigée par une série de monarques, les shahs (ce terme signifie « roi » ou « empereur » en persan).
Carte de l’Iran au Moyen-Orient
En 1935, la Perse adopte le nouveau nom d’Iran, étymologiquement « pays des aryens », en signe d’amitié avec l’Allemagne nazie. A partir de la Seconde guerre mondiale, l’Iran devient un allié fidèle des puissances occidentales, notamment des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Ceux-ci exercent un contrôle vigilant sur les ressources naturelles du pays, notamment à travers la mainmise de l’Anglo-Iranian Oil Company (AIOC).
Cette forte dépendance à l’égard des puissances étrangères favorise un réveil nationaliste du peuple iranien. Ainsi, l’année 1951 voit l’arrivée au pouvoir de Mohammad Mossadegh. Porté au pouvoir par les religieux chiites et les communistes, il décrète une nationalisation totale des ressources pétrolières iraniennes, afin d’en faire profiter les fruits à son peuple. Cette politique d’indépendance nationale marquée irrite le shah et les occidentaux, qui conviennent de renverser Mossadegh par un coup d’état. L’Opération Ajax est ainsi mise sur pied par la CIA et le MI6 en 1953. Renversé par l’armée, Mossadegh est inculpé de haute-trahison, condamné à trois ans de prison puis assigné à résidence jusqu’à sa mort.
Les années 50, 60 et 70 sont marquées par l’autoritarisme grandissant du shah Mohammad Reza Pahlavi, au pouvoir depuis 1941. Celui-ci dirige son pays d’une main de fer, menant une politique pro-américaine, résolument laïque et modernisatrice. Toute opposition est durement réprimée par la police secrète, la SAVAK, et les assassinats politiques se comptent par milliers. Le shah souhaite mener une politique d’occidentalisation du pays et de ses mœurs. Son règne est notamment marqué par la reconnaissance du droit de vote aux femmes en 1963. Le père de Reza Pahlavi était allé jusqu’à interdire aux femmes le port du voile islamique dans les lieux publics, à partir de 1936. Ces mesures provoquent la colère d’une partie de la population, profondément conservatrice et attachée à l’Islam chiite.
Ce ressentiment conduit le peuple à se révolter en 1979. La monarchie est renversée et la République islamique proclamée, faisant du pays une théocratie chiite. Cette révolution est marquée par l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeiny, ecclésiastique exilé d’Iran depuis 1964 pour son opposition au shah. Le dignitaire chiite prend alors le titre de « guide de la révolution islamique ». L’exécutif iranien devient bicéphale, partagé entre un président élu au suffrage universel et le guide, nommé par une assemblée de dignitaires religieux, l’assemblée des experts, elle-même élue au suffrage universel. Cependant, c’est bien le guide de la révolution qui détient la réalité du pouvoir politique. Il peut, par exemple, limoger s’il le souhaite le président de la République.
Dès lors, une dictature cède la place à une autre, alors que l’équilibre géopolitique du Moyen-Orient se trouve bouleversé. De principal allié des Etats-Unis dans la région, l’Iran devient son principal ennemi. L’ayatollah Khomeiny emploie ainsi régulièrement le terme de « grand Satan » pour désigner les Etats-Unis. Cette opposition entre les deux puissances culmine avec la crise des otages, lorsqu’en 1979, 56 membres du personnel diplomatique américain à Téhéran sont séquestrés par les révolutionnaires, suite à l’assaut de l’ambassade américaine par une foule en colère. Mais, dans un contexte de Guerre froide, l’Iran n’intègre pas pour autant le Bloc de l’Est. L’islamiste conservateur Khomeiny n’éprouve en effet que du mépris pour l’athéisme d’Etat professé par l’Union soviétique.
Dès ses débuts, l’histoire de la République islamique d’Iran est donc mouvementée. En 1980, un an à peine après sa proclamation, la République islamique est envahie par l’Irak baasiste de Saddam Hussein. L’armée iranienne, restée neutre durant la révolution, tient bon et repousse l’attaque irakienne, au prix d’une guerre de tranchées sanglante, ponctuée d’attaques aux armes chimiques, qui durera huit ans et entraînera la mort de près d’un million de personnes. Saddam Hussein, qui entretenait déjà de mauvaises relations avec le shah, s’impose dès lors comme l’ennemi héréditaire de l’Iran. Or, celui-ci est renversé en 2003, à la faveur de l’invasion américaine de l’Irak.

Le shah Mohammad Reza Pahlavi, Houari Boumédiène et Saddam Hussein, lors de la signature des accords d'Alger en 1975

Le shah Mohammad Reza Pahlavi, Houari Boumédiène et Saddam Hussein, lors de la signature des accords d'Alger en 1975
Son ennemi mortel éliminé, l’Iran a désormais le champ libre pour avancer ses pions au Moyen-Orient, devenant ainsi une véritable puissance hégémonique dans la région. La guerre en Irak de 2003 constitue en effet le point de départ d’un retour en force de l’Iran sur la scène internationale, qui culminera avec la constitution de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’arc chiite ».
Nous centrerons donc notre propos autour de la question suivante :
Dans quelle mesure l’Iran s’est-il affirmé comme une puissance hégémonique au Moyen-Orient depuis 2003 ?
A partir de 2003, l’Iran passe du statut de puissance isolée et marginalisée (I) à celui d'acteur régional incontournable au Moyen-Orient (II).
I) Le retour en force de l’Iran sur la scène internationale suite à l’intervention américaine en Irak de 2003
Durant les premières années du XXIe siècle, l’Iran passe du statut de puissance isolée et marginalisée à celui d’acteur géopolitique incontournable (A) ; la « divine surprise » de la guerre en Irak de 2003 achève de consacrer le retour en force de ce pays sur la scène internationale (B).
A) L’Iran, de puissance isolée et marginalisée à acteur incontournable des relations internationales
En 2003, l’Iran apparaît comme une puissance isolée sur la scène internationale. Le pays doit en effet faire face à un embargo et à des sanctions imposées par l’Occident. Les premières sanctions contre l’Iran ont été prises par les Etats-Unis dès 1979, en réaction à la prise d’otage du personnel de l’ambassade américaine par des militants islamistes. L’embargo, lui, a débuté en 1984 et concernait à l’origine les exportations d’armes vers le régime des ayatollahs. Les Etats-Unis reprochaient à l’Iran son soutien au mouvement du Hezbollah, groupe armé chiite libanais responsable d’un attentat à Beyrouth en 1983 qui coûta la vie à 241 soldats américains, 58 militaires français et 6 civils libanais. Cet embargo sur les armes n’empêchât pas les Etats-Unis, Israël mais aussi la France de fournir clandestinement du matériel militaire à l’Iran tout au long de sa guerre contre l’Irak.
Au fur et à mesure, les sanctions contre l’Iran se sont étendues à des domaines aussi divers que l’énergie, la finance ou le commerce en général. Tout contrevenant à ces sanctions prend alors le risque de se voir infliger une amende par la justice des Etats-Unis, en vertu du principe d’extra-territorialité du droit américain. Ce fut le cas de la multinationale Total, contrainte en 1996 de payer 300 millions de dollars aux Etats-Unis ou de BNP Paribas, condamnée en 2015 à une amende record de 8,9 milliards de dollars (7,9 milliards d’euros). En avril 2018, la justice américaine condamne la société chinoise ZTE à une amende de plus d’un milliard de dollars et lui impose la présence d’un conseiller en intégrité pendant trois ans. En mai 2018, un banquier turc écope même de trente-deux mois de prison pour contournement de l’embargo sur l’Iran.
Les années 2003-2005 sont marquées par la fin de mandat du président iranien Mohammad Khatami. Ce religieux modéré, considéré comme le premier président iranien réformiste, se fait élire sur des promesses d’amélioration de l’Etat de droit et de la condition féminine, de démocratisation des institutions et de participation accrue des Iraniens à la vie politique. Il se prononce pour davantage de liberté d’expression et de tolérance religieuse.
Cependant, ces promesses de réformes restent en grande partie lettre morte en raison de l’opposition des éléments les plus conservateurs du régime. Le président modéré hérite également d’une situation économique critique, aggravée par les sanctions occidentales. Le fort taux de chômage et l’absence de perspectives d’avenir amènent la jeunesse à éprouver une forme de désillusion vis-à-vis des promesses de la révolution islamique. Le mandat de Khatami est ainsi émaillé par une série de manifestations étudiantes, durement réprimées par le Hezbollah et par les Basidj, des miliciens au service du régime.
De plus, les promesses de démocratisation de Khatami ne convainquent pas tout à fait l’Occident, et notamment les Etats-Unis. L’administration du président George W Bush, fortement influencée par le courant des néo-conservateurs, va jusqu’à renforcer les sanctions envers l’Iran en 2004 et à placer le pays sur la liste de l’Axe du mal en 2002. Cette expression désigne les pays qui, selon George W Bush, cherchent à se procurer des armes de destruction massive et financent le terrorisme. L’Iran est placé sur la liste des « états-voyous » (rogue states) par les Etats-Unis, qui cherchent à faire de la République islamique une sorte de paria international.
Cette défiance entre l’Iran et les puissances occidentales atteint son paroxysme à partir de 2005, suite à la victoire de Mahmoud Ahmadinejad à l’élection présidentielle. Cet ancien basidj, issu de la frange conservatrice du régime, se distingue par une rhétorique provocatrice, belliciste et particulièrement agressive vis-à-vis de l’Occident.
Il envoie ainsi une lettre à Bush lui conseillant de se convertir à l’Islam, et organise une conférence où il affirme qu’Israël devrait être « effacé des pages du temps », manifestant par là un antisionisme radical. Il accuse également l’Etat juif de « se comporter comme Hitler ». En 2006, le président américain qualifie dans son discours sur l’état de l’Union le régime iranien de « petite élite cléricale qui isole et opprime son peuple ». Ahmadinejad lui répond sèchement, accusant les Etats-Unis d’avoir « jusqu’au coude, les mains dans le sang des peuples », d’être « impliqués partout où il y a des guerres et l’oppression », d’avoir tué « des gens par millions », de soutenir « les crimes du régime fantoche sioniste » et « la destruction des maisons des Palestiniens » et donc à ce titre, affirme que les dirigeants américains ne sont « pas qualifiés pour parler des droits de l’Homme et des libertés ».

Mahmoud Ahmadinejad, président de l’Iran de 2005 à 2013
En 2010, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, il accuse les Etats-Unis et leurs alliés d’avoir instrumentalisé l’Holocauste et les attentats du 11 septembre à des fins politiques et géostratégiques, citant notamment le conflit israélo-palestinien et l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001. Il se fait également l’écho de théories conspirationnistes concernant le 11 septembre et la Shoah, en laissant sous-entendre que ces événements pourraient être des manipulations. Ces déclarations conduisent les délégations des Etats-Unis et de plusieurs pays occidentaux à quitter la salle prématurément lors de son discours.
Ahmadinejad revendique pour l’Iran le droit de se doter de l’arme atomique pour assurer sa sécurité. Il relance alors le programme nucléaire iranien, ce qui amène les Etats-Unis à renforcer les sanctions vis-à-vis de son régime. La reprise de ce programme nucléaire conduit à une aggravation des tensions entre l’Iran et Israël, qui considère son voisin perse comme une menace existentielle et comme son ennemi principal dans la région. L’ entité sioniste envisage plusieurs fois de mener des frappes aériennes sur les installations atomiques iraniennes pour porter un coup d’arrêt au programme nucléaire, comme il l’a fait par le passé en Irak ou encore en Syrie. Ahmadinejad menace alors Israël de représailles armées et de destruction, laissant planer le spectre d’un conflit généralisé au Moyen-Orient, voire même d’une Troisième guerre mondiale.
Les deux mandats d’Ahmadinejad constituent donc un point critique dans l’isolement de l’Iran sur la scène internationale. La déstabilisation interne du régime suit également son cours. En 2009, la réélection d’Ahmadinejad au poste de président est contestée par une partie de l’opposition. Celle-ci déclenche une série de manifestations dans le pays, les plus importantes depuis la révolution islamique. Une fois de plus, ces manifestations pacifiques sont durement réprimées par le pouvoir politique. Plusieurs rapports occidentaux font état de centaines de victimes.
Durant ses deux mandats, Mahmoud Ahmadinejad entame toutefois une normalisation de ses relations diplomatiques avec la Russie. Je suis allé à la rencontre de Denis Bauchard, ancien diplomate et conseiller pour le Moyen-Orient à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI). Selon lui, la « détente » amorcée entre Mahmoud Ahmadinejad et Vladimir Poutine constitue l’un des points de départ du retour en force du régime des mollahs sur la scène internationale. Paradoxalement, la Russie passe alors du statut d’ennemi héréditaire à celui d’allié privilégié de l’Iran dans la région. Rappelons que l’URSS de Staline était intervenue aux côtés du Royaume-Uni de Churchill en 1941 pour renverser Reza Chah Pahlavi, inquiets du rapprochement diplomatique entre son pays et l’Allemagne nazie.
La révolution iranienne de 1979 se distinguait également par son opposition à l’Union soviétique, qualifiée à l’époque de « petit Satan ». Mais au XXIe siècle, les deux puissances ont progressivement adopté une attitude de realpolitik respective. « Les relations entre les deux pays se sont améliorées grâce aux sanctions » m’affirme Denis Bauchard. Le Kremlin était en effet trop content de se trouver un nouvel allié pour renforcer son influence au Moyen-Orient, en faisant contrepoids aux Etats-Unis.
Des scientifiques russes collaborent ainsi avec l’Iran dans le domaine de l’énergie atomique. En 2009, la construction en Iran d’une centrale nucléaire par une société russe est achevée. La Russie fournit également de l’armement, y compris balistique, aux Iraniens. En 2015, et après des années d’hésitation, Vladimir Poutine autorise la livraison de missiles S-300 à l’Iran. La compagnie pétrolière russe Gazprom s’implante également progressivement dans le pays. Néanmoins, la relation entre l’Iran et la Russie reste parfois difficile. Selon Denis Bauchard, les deux pays demeurent des « puissances rivales au Moyen-Orient ». En 2005, l’Occident accuse ainsi le régime d'Ahmadinejad de financer et d’entraîner les rebelles islamistes tchétchènes qui se battent contre la Russie. Le président iranien dément formellement, affirmant que le conflit en Tchétchénie est « une affaire interne » à la Russie.
Les présidents russe et iranien Vladimir Poutine et Mahmoud Ahmadinejad
Outre la Russie, le régime des ayatollahs peut compter sur le soutien indéfectible de la Syrie. Ce pays est en effet un allié stratégique de l’Iran depuis qu’Hafez el-Assad, un militaire issu de la minorité alaouite, a pris le pouvoir par un coup d’état. Les alaouites constituent une branche ésotérique et initiatique du chiisme, et sont considérés comme des hérétiques par la majorité des théologiens musulmans. Les militaires alaouites scellent toutefois une alliance paradoxale avec le régime islamiste conservateur iranien.
Au début du XXIe siècle, le régime iranien peut aussi compter sur le soutien du Yémen, dirigé par le chiite Ali Abdallah Saleh. La présence du Hezbollah au Liban depuis 1982 offre également à l’Iran un allié de poids au Moyen-Orient. Ce groupe islamiste chiite, armé et financé par l’Iran et fort de 20 000 à 25 000 membres constitue une sorte de deuxième armée pour le régime des ayatollahs. Au Liban, il demeure une force politique et sociale incontournable, comptant même 15 députés au Parlement. En 2006, les miliciens du Hezbollah repoussent l’intervention militaire israélienne au Liban. Ce fait d’arme constitue à ce jour la seule victoire d’une armée arabe sur les troupes de Tsahal. En 2009, l’alliance scellée entre le général chrétien et futur président Michel Aoun et le Hezbollah consacre la suprématie politique de l’organisation chiite sur le Liban. La religion est ainsi utilisée comme un vecteur d’influence par les ayatollahs iraniens.
L’opposition virulente entre Israël et l’Iran pousse également la République islamique à s’implanter en Palestine. Le régime des mollahs fournit ainsi armes et financements au Hamas, un groupe islamiste partisan de la lutte armée contre Israël. Paradoxalement, le Hamas professe une lecture assez radicale de l’Islam sunnite. Cette alliance antisioniste de circonstance dénote un réel pragmatisme de la part des dirigeants iraniens. Ceux-ci apparaissent non pas comme des fanatiques ou des idéologues, mais bien comme des politiciens à sang froid, prêts à mettre de côté leur intransigeance religieuse si nécessaire, comme le montre leur relation avec les élites alaouites syriennes. En effet, si l’Iran n’a qu’un objectif, c’est bien de consolider sa puissance et son hégémonie au Moyen-Orient. Ce pragmatisme et cette capacité à tirer profit de chaque situation constituent les atouts majeurs des dirigeants iraniens. Selon Denis Bauchard, qui parle d’une « politique d’aubaines », les mollahs iraniens ne font qu’« utiliser un certain nombre d’occasions pour accroître leur influence ».
A l’occasion d’un entretien, j’ai également pu rencontrer Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn et président du groupe d’amitié France-Iran au Sénat. Selon lui, l’Iran perse se considère paradoxalement comme « le nouveau défenseur de la nation arabe et des Palestiniens, les autres pays du Moyen-Orient ayant abandonné le combat ». L’Arabie saoudite sunnite, principal ennemi géopolitique de l’Iran au Moyen-Orient, tente en effet depuis plusieurs années de se rapprocher d’Israël et de pousser les Palestiniens à la modération. Les membres de la famille régnante des Saoud étaient ainsi qualifiés
d’« usurpateurs » par l’ayatollah Khomeiny.
L’entretien et le financement par l’Iran de groupes armés au Proche-Orient constituent un aspect majeur de sa politique étrangère, et obéit à la même logique que le soutien aux kurdes irakiens de la part du dernier shah. En effet, selon Denis Bauchard, la République islamique « poursuit en grande partie la politique étrangère du shah », « il y a bien une constante iranienne, une volonté de reconstruire l’empire perse ». Depuis 1979, cette politique se traduit donc par une « volonté d’exporter la révolution iranienne ».
S’amorce alors la construction de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler l’arc géopolitique chiite au Moyen-Orient. L’Iran des mollahs est relié à la mer Méditerranée par le Liban, quasiment contrôlé par le Hezbollah, et la Syrie, dirigée par les alaouites. Cette alliance politico-religieuse se conçoit, selon Denis Bauchard, comme un « axe de la résistance », un « front du refus à l’impérialisme israélo-américain ». En 2003, il reste un seul chaînon manquant pour achever la construction de cet arc chiite : l’Irak.
B) La guerre en Irak de 2003, touche finale à la construction de l’arc chiite
La politique interventionniste de George W Bush achève d’éliminer les obstacles à l’ascension de l’Iran au Moyen-Orient. Ancien gouverneur du Texas, George W Bush est un président qualifié par Denis Bauchard de « très idéologue ». Proche du Tea Party et des évangélistes, il compte également de nombreux soutiens dans les cercles néo-conservateurs. Ce courant de pensée géopolitique considère que la sécurité et l’ordre international ne sont pas des fins en soi. Selon eux, une diplomatie doit être fondée sur la promotion de la liberté, du libre-échange et de la démocratie à travers le monde, y compris par la force militaire si besoin est. Selon Denis Bauchard, « cette forme de wilsonisme botté part du principe que tous les problèmes au Moyen-Orient peuvent être résolus par la volonté de promouvoir la démocratie et la liberté économique ».
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 entraînent ainsi une réponse immédiate de la part de George W Bush. Celui-ci intervient en Afghanistan, pays frontalier de l’Iran, pour renverser le régime des talibans, accusés de faire de leur pays une base arrière pour les djihadistes d’Al-Qaïda. Or, l’Iran n’a jamais vu d’un bon œil la présence de ces fondamentalistes sunnites si près de ses frontières. L’intervention militaire de 2001 débarrasse l’Iran d’un ennemi supplémentaire. Les talibans chassés du pouvoir, il ne restait plus aux Etats-Unis qu’à supprimer l’ennemi mortel de l’Iran : l’Irak baasiste de Saddam Hussein.
Soutien de Mohammad Reza Pahlavi au séparatisme kurde, guerre à outrance entre 1980 et 1988, l’Iran et l’Irak étaient restés jusqu’alors les deux régimes les plus antagonistes possible au Moyen-Orient. En 2003, l’administration Bush accuse, sur la base de fausses preuves, le régime de Saddam Hussein de chercher à développer des armes de destruction massive et de donner refuge à des membres d’Al-Qaïda. Une intervention militaire conduit à la défaite de l’armée irakienne et au renversement de Saddam Hussein en à peine trois mois.
La chute de Saddam Hussein, ennemi héréditaire du régime iranien, constitue pour les ayatollahs une forme de « divine surprise ». La population de l’Irak est en effet constituée majoritairement de chiites. Potentiels soutiens du régime perse, les dignitaires chiites irakiens avaient été marginalisés et tenus à l’écart du pouvoir par Saddam Hussein, de confession sunnite. Nombre de ces leaders chiites avaient alors été contraints de s’exiler en Iran.
La chute du régime irakien inverse le rapport de force politico-religieux dans le pays. Elle conduit les forces d’occupation américaine à marginaliser et à écarter du pouvoir les sunnites, proches de Saddam Hussein. Les chiites prennent alors le pouvoir à Bagdad, et amorcent un rapprochement diplomatique avec l’Iran, qui apparaît comme le grand gagnant de la guerre en Irak de 2003.
Les Etats-Unis favorisent ainsi l’accession du chiite Nouri al-Maliki au poste de Premier ministre de l’Irak en 2006. Mais même ses parrains américains finissent par s’émouvoir de sa proximité avec l’Iran, dont il ne fait pas mystère. Les responsables états-uniens reprochent également à Nouri al-Maliki ses propos véhéments à l’égard des sunnites, assimilés au régime de Saddam Hussein et marginalisés par le nouveau pouvoir irakien. Al-Maliki ne fait rien pour les protéger des exactions des milices chiites, soutenues par l’Iran, qui prolifèrent dans le pays après 2003.
La chute de Saddam Hussein constitue en effet pour l’Irak le point de départ d’une guerre civile à caractère confessionnel. Les humiliations et les vexations subies par les sunnites poussent ceux-ci à s’organiser en groupes armés, dont les plus violents et les plus radicaux constitueront le noyau dur de la future organisation Etat islamique. Au fil des années, l’Irak s’enfonce dans le chaos et dans une spirale de vendettas. Cette situation catastrophique, aggravée par le retrait des troupes d’occupation américaines en 2011 laissera le champ libre à l’Iran pour s’implanter durablement dans le pays et y asseoir son contrôle.
L’intervention américaine constitue donc « une aubaine pour l’Iran » et le véritable « point de départ de l’influence iranienne au Moyen-Orient », « George W Bush, par sa méconnaissance des dossiers, a laissé le champ libre aux Iraniens », estime Denis Bauchard. « A l’époque, les diplomates américains étaient consternés par la décision de Bush » ajoute-t-il. Rappelons qu’après l’invasion ratée du Koweït par l’Irak en 1990-1991, le président américain George Bush senior avait pris la décision de laisser Saddam Hussein au pouvoir à Bagdad, pour faire contrepoids à l’influence iranienne dans la région. Déjà à l’époque, les néo-conservateurs s’étaient opposés à cette décision. Ce fut le cas du secrétaire d’état Dick Cheney, qui deviendra vice-président durant les deux mandats de George W Bush. Les Etats-Unis ont depuis pris acte de la proximité géopolitique entre l’Iran et l’Irak. Le président américain Donald Trump ira jusqu’à exempter l’Irak des restrictions liées aux sanctions iraniennes, permettant au pays de mener des relations commerciales avec son voisin perse.
Cette mainmise de la République islamique sur l’Irak sera toutefois dénoncée par plusieurs personnalités irakiennes importantes. Ainsi, l’ayatollah Ali al-Sistani, figure du chiisme irakien et personnalité politique importante, a demandé à l’Iran de « respecter la souveraineté irakienne ». Il a également appelé à la dissolution des milices chiites et à leur incorporation dans l’armée régulière irakienne. Moqtada al-Sadr, étoile montante de la politique irakienne se définissant comme un « nationaliste chiite » s’est également montré critique envers l’hégémonie iranienne dans son pays. Mais ces critiques, si elles peuvent être partagées par une grande partie de la population, demeurent minoritaires au sein de la classe politique irakienne, qui sait ce qu'elle doit à l'Iran.
En 2008, Nouri al-Maliki reçoit Mahmoud Ahmadinejad en Irak. Cette rencontre constitue la première visite officielle d’un président iranien dans le pays.
Ci-dessus, une visite officielle de Nouri al-Maliki en Iran en 2010. Il y rencontre l’ayatollah et guide de la révolution Ali Khamenei.
Le départ des troupes américaines d’Irak et les tensions inter-religieuses vont favoriser l’ascension du groupe armé Etat islamique (EI). Cette organisation terroriste sunnite, composée en partie de soldats de Saddam Hussein démobilisés après 2003, va conquérir les villes de Fallujah, de Tikrit et de Mossoul, en ne rencontrant qu’une faible résistance de la part de l’armée irakienne. L’ascension fulgurante de ce groupe radical ne sera stoppée qu’aux portes de Bagdad.
Le risque d’effondrement de l’Etat irakien, et les exactions à caractère quasi-génocidaire dont se rendent coupables les djihadistes de l’EI à l’égard des chiites, poussent l’Iran à intervenir militairement pour soutenir son allié. Cette présence militaire iranienne en Irak constitue le parachèvement final de la construction de l’arc chiite au Moyen-Orient. La République islamique ne compte en effet plus aucun ennemi entre elle et la Méditerranée. Elle a désormais le champ libre pour asseoir sa domination sur les pays de l’arc chiite.
Depuis le début du XXIe siècle, une série de facteurs internationaux ont permis à l’Iran de passer d’une situation de paria à celle d’acteur régional incontournable au Moyen-Orient. Après la chute de Saddam Hussein, ses interventions militaires successives vont achever d’asseoir sa domination sur le Moyen-Orient chiite.
II) L’Iran, acteur régional incontournable et puissance hégémonique au Moyen-Orient
Le renforcement de l’hégémonie iranienne sur l’arc chiite (A) conduit le pays à devenir une puissance incontournable, traitant d’égal à égal avec les occidentaux (B)
A) Le renforcement de l’hégémonie iranienne sur les pays de l’arc chiite
Le risque pour l’Iran de voir son voisin et allié irakien passer sous le contrôle de l’Etat islamique, violemment anti-chiite et anti-iranien, pousse le régime des mollahs à intervenir militairement dans le pays.
Cette intervention militaire passe par le renforcement du contrôle des milices chiites irakiennes par l’Iran. Celles-ci deviennent la principale force d’opposition à Daech dans le pays, l’armée irakienne étant désorganisée et démoralisée. Ces miliciens chiites, faisant parfois preuve d’une grande violence envers les civils sunnites, sont épaulés par des combattants de la force Al-Qods, les pasdarans, rattachés au corps des Gardiens de la révolution.
Le corps des Gardiens de la révolution islamique a été créé en 1979 par un décret de l’ayatollah Khomeiny. Cette force militaire, bien entraînée et bien équipée, dépend directement du guide de la révolution islamique. Alors que l’armée régulière iranienne a pour fonction de défendre les frontières de son pays et d’y maintenir l’ordre, les Gardiens de la révolution ont pour mission de défendre le système politique de la République islamique. La force Al-Qods désigne la branche des Gardiens de la révolution opérant à l’étranger. Al-Qods, qui signifie « le lointain » en arabe, est le nom donné par les musulmans à la ville sainte de Jérusalem. Symboliquement, la force Al-Qods est donc composée des combattants qui, un jour peut-être, seront chargés de reprendre Jérusalem aux Israéliens.
Dirigée par le général Qasem Soleimani depuis 1998, la force Al-Qods et son chef deviennent les pièces maîtresses de l’expansion iranienne au Moyen-Orient.
Le général Qasem Soleimani, commandant militaire de la force Al-Qods depuis 1998.
Reconnu comme un brillant tacticien, y compris par ses adversaires occidentaux, Qasem Soleimani peut être considéré comme l’un des maîtres d’œuvre de la construction de l’arc chiite. Dépêché en Irak quelques heures après la chute de Mossoul en 2014, il supervise des opérations militaires contre Daech, qui sont toutes couronnées de succès. Il participe ainsi à la prise des villes de Tikrit et de Falloujah à l’OEI. En Iran, Soleimani est célébré comme un véritable héros national pour sa bravoure et son patriotisme.
Image de propagande représentant Soleimani devant la Maison blanche en feu. Le terme « anti-américain » devient ici un doux euphémisme.
Ces victoires iraniennes permettent aux Gardiens de la révolution de porter à bout de bras le régime irakien, assurant ainsi sa survie. L’Iran verse également à l’Irak une aide financière pour pallier les importantes destructions matérielles causées par des années de guerre civile. Les dirigeants irakiens se considèrent donc, à de nombreux égards, comme redevables vis-à-vis de l’Iran. Ce dernier a sauvé l’Etat et l’économie de l’Irak de l’effondrement et a grandement contribué aux défaites militaires de Daech dans le pays.
Denis Bauchard considère Qasem Soleimani comme un « véritable pro-consul iranien en Irak », assimilant donc ce pays à une colonie iranienne. Par analogie avec l’empire perse achéménide, il aurait pu employer le terme de satrape, qui désignait les gouverneurs administratifs des provinces de l’empire. L’Irak est donc progressivement devenue une sorte de neo-satrapie perse depuis 2003.
La consolidation de l’arc chiite connaît néanmoins un coup d’arrêt suite aux Printemps arabes. En 2011, comme d’autres pays de la région, la Syrie est en effet le théâtre d’importantes manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Les insurgés protestent principalement contre la corruption endémique, le clanisme du régime alaouite, le chômage et le manque de perspectives d’avenir pour la jeunesse. Ces manifestations, réprimées par les forces de sécurité, dégénèrent rapidement en guerre civile.
Le président Bachar el-Assad, dirigeant de la Syrie depuis 2000
La rébellion, soutenue par les pays occidentaux, les monarchies du Golfe et composée principalement de sunnites, développe rapidement une idéologie salafiste et djihadiste radicale, anti-chiite et anti-iranienne. Le régime de Damas menace de chuter à plusieurs reprises. Pour l’Iran, l’idée de voir un gouvernement allié remplacé par un régime islamiste sunnite et hostile apparaît comme inacceptable. Une fois encore, l’Iran intervient militairement dans un pays étranger afin de combattre aux côtés du régime syrien, contribuant ainsi à sa survie. Outre 6000 à 7000 combattants du Hezbollah libanais, le régime syrien peut compter sur l’appui de nombreux mercenaires chiites venus d’Irak, d’Afghanistan ou du Pakistan, formés et encadrés par la République islamique.
Logo de la milice chiite syrienne Junud al-Mahdi (les soldats du Messie, en arabe), alliée à Bachar el-Assad. On peut y voir le président syrien représenté aux côtés de l’ayatollah Khamenei et du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
L’Iran envoie également 20 000 à 30 000 soldats dans le pays, dont 3000 à 4000 combattants de la force Al-Qods. Qassem Soleimani participe ainsi à la prise de la ville d’Alep par les troupes syriennes, bataille durant laquelle il est légèrement blessé. Enfin, de nombreux militants palestiniens gagnent la Syrie pour combattre au côté du régime d’el-Assad. L’arc chiite porte ses fruits, et permet désormais de mobiliser des combattants dans de nombreux pays du Moyen-Orient. L’Iran est maintenant susceptible de faire basculer chaque conflit dans la région en sa faveur.
La Russie, alliée de l’Iran et de la Syrie, envoie également une partie de son armée soutenir Bachar el-Assad. L’aviation russe mène en effet de nombreuses frappes aériennes sur les villes tenues par les rebelles et par l’Etat islamique. « Les deux grandes puissances se sont coordonnées. L’Iran a envoyé ses troupes au sol, et les Russes ont mené des frappes aériennes », déclare Denis Bauchard. Cette alliance militaire permet à l’Iran et à la Russie d’inverser le cours du conflit et de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. « Les Russes en l’air et les Iraniens au sol. Ils ont fait le boulot », résume Philippe Bonnecarrère.
La guerre en Syrie, à l’origine guerre civile localisée, devient donc au fil des années un conflit régional, puis international. La Syrie, l’Iran et la Russie s’opposent en effet par procuration à l’Arabie saoudite, au Qatar, à Israël, aux Etats-Unis, à la France et au Royaume-Uni, parrains de la rébellion syrienne. Mais face à toutes ces grandes puissances, l’alliance iranienne finit par l’emporter. Le message adressé aux occidentaux est clair : la prochaine fois que vous voudrez renverser un allié de l’Iran, vous trouverez une importante force militaire pour vous en empêcher. Cette force militaire est capable de tenir tête à n’importe quel pays.
Le Printemps arabe emporte toutefois un allié important de l’Iran : le régime yéménite du chiite Ali Abdallah Saleh. Pour la République islamique, entretenir de bonnes relations avec un pays frontalier de l’Arabie saoudite et offrant un débouché sur le golfe d’Aden constituait une véritable aubaine. Mais en 2011, comme en Syrie, une série de manifestations soutenues par l’Occident et les Saoudiens ébranle le pays. Là encore, les manifestants réclament de meilleures conditions de vie, ainsi que la fin de la corruption et du clanisme qui gangrènent le régime. Cette insurrection conduit au départ du président Saleh, remplacé par le sunnite Abdrabbo Mansour Hadi, proche de l’Arabie saoudite.
Mais les partisans chiites de Saleh, surnommés les houthis, s’organisent très vite en une rébellion armée. Comme en Syrie, la situation dégénère en guerre civile généralisée. Le gouvernement et les forces loyalistes peuvent compter sur l’appui de l’Arabie saoudite et de plusieurs pays sunnites, qui interviennent militairement dans le pays. L’Iran, désireux de maintenir son contrôle sur le Yémen, apporte son soutien aux rebelles houthis. La République islamique et la Corée du Nord, pays allié de l’Iran, fournissent ainsi des missiles scud aux rebelles, dont certains ont été tirés sur le territoire saoudien. Le Hezbollah participe également aux affrontements.
Comme le conflit syrien, la guerre civile yéménite peut donc être considérée comme une guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite, similaire à celles que se livraient les Etats-Unis et l’URSS au temps de le Guerre froide. Les parallèles sont en effet nombreux : deux modèles politico-philosophiques inconciliables, volontés hégémoniques, constitution de
« blocs » et d’alliances. L’arc chiite peut ainsi être considéré comme un « bloc » iranien au Moyen-Orient, en opposition à un bloc américain, principalement constitué autour de l’Arabie saoudite, l’autre puissance hégémonique dans la région et, à ce titre, ennemi juré de l’Iran.
« blocs » et d’alliances. L’arc chiite peut ainsi être considéré comme un « bloc » iranien au Moyen-Orient, en opposition à un bloc américain, principalement constitué autour de l’Arabie saoudite, l’autre puissance hégémonique dans la région et, à ce titre, ennemi juré de l’Iran.
Il reste néanmoins une dernière étape pour achever le retour en force de l’Iran sur la scène internationale : l’amélioration des relations avec les Etats-Unis et leurs alliés.
B) L’Iran et les Occidentaux, retour en grâce ou poursuite de l’isolement ?
Pour que l’Iran puisse véritablement asseoir son hégémonie au Moyen-Orient, il lui reste encore à améliorer ses relations avec les puissances occidentales. Or, cette question est loin d’être réglée.
En juillet 2015, le retour en grâce de l’Iran sur la scène internationale était en passe d’être achevé. A cette date, la République islamique avait en effet signé à Vienne un accord avec les principales grandes puissances. Cet accord, prévoyait une suppression progressive des sanctions économiques contre l’Iran, en échange d’un abandon définitif de son programme nucléaire militaire. Ce plan d’action global avait été signé par les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de l’Iran, de la France, de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Union européenne.
Les signataires de l’accord sur le nucléaire iranien, à Vienne, le 14 juillet 2015
Selon tous les contrôles opérés par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), l’Iran a tenu parole et s’est plié à ses obligations. La levée des sanctions permet à l’économie de la République islamique d’atteindre des taux de croissance de 12,5% entre 2015 et 2018. Des milliards de dollars d’avoirs financiers iraniens gelés depuis la révolution retournent entre les mains du régime. Durant, cette période, l’Iran dégage également d’immenses revenus grâce à l’exportation de son pétrole et signe des contrats avec plusieurs entreprises européennes telles que Total, Airbus ou encore Renault. Les relations avec la France s’améliorent, comme en témoigne en mars 2018 l’inauguration d’une exposition intitulée « Le Louvre à Téhéran », comprenant de nombreuses œuvres du musée parisien. Cet événement, qui a réuni le ministre des affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif et son homologue français Jean-Yves le Drian, était supposé resserrer les liens culturels entre les deux pays.
Denis Bauchard m’explique que « avant l’élection de Barack Obama, le gouvernement américain avait une politique de changement de régime vis-à-vis de l’Iran ». L’idée était de provoquer un appauvrissement de la population par des sanctions économiques, afin que celle-ci reporte sa colère sur le régime, se révolte, et provoque la chute des mollahs. Mais la population iranienne a majoritairement continué de soutenir son régime, en ne reportant sa colère que sur les Etats-Unis et Israël. En effet, selon Denis Bauchard, « les sanctions économiques favorisent naturellement le
nationalisme ».
nationalisme ».
Barack Obama a donc pris acte de l’échec d’une telle politique et a entamé un rapprochement diplomatique avec l’Iran et Cuba, considérant que l’ouverture aux capitaux étrangers amènerait nécessairement une demande grandissante de liberté et de démocratie.
Cependant, aux yeux des Etats-Unis, l’accord sur le nucléaire iranien a peut-être trop bien marché pour la République islamique. La phase de croissance soutenue de l’économie iranienne, après plusieurs années de récession, a fait prendre conscience aux dirigeants américains du potentiel gigantesque de l’ancienne Perse. Celle-ci dispose en, effet de tous les atouts possibles pour devenir une puissance hégémonique au Moyen-Orient, que ce soit en termes de ressources, en termes militaires, économiques, historiques, culturels ou démographiques.
La période 2015-2018 correspond également à la période de consolidation importante du croissant chiite. « La suppression des sanctions économiques a laissé le champ libre à l’Iran pour mener sa politique d’influence », m’explique Denis Bauchard. Cette influence persane grandissante finit par inquiéter profondément Israël, dont l’influence est « un élément déterminant dans la politique américaine » selon Denis Bauchard. L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en 2016 remet toutefois en cause les plans iraniens. Comme annoncé durant sa campagne, Trump retire son pays de l’accord sur le nucléaire, qu’il qualifie de « pire accord » jamais signé par son pays. Parallèlement, il annonce le rétablissement du « plus haut niveau de sanctions » à l’égard de l’Iran, espérant que ces sanctions auront raison du régime des ayatollahs. Donald Trump et les membres de son administration n’ont de cesse de dénoncer « l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient » et se présentent comme des alliés indéfectibles de l’Arabie saoudite, qui accueille la première visite diplomatique officielle de Trump en 2017.
De plus, les relations entre l’Iran et les puissances européennes ne se sont pas améliorées. Malgré les protestations des pays de l’UE contre le retrait américain et la mise en place d’Instex, un mécanisme de contournement des sanctions, les relations entre l’Iran et l’Europe ne sont pas au beau fixe. Philippe Bonnecarrère déplore ainsi les « relations difficiles » entre la France et la République islamique, ainsi que le fait que l’Iran « se recroqueville comme une huître » et se présente sans cesse comme la « victime d’un complot occidental ». Ainsi, malgré le fait qu’Emmanuel Macron et Hassan Rohani « se parlent régulièrement », le déplacement en Iran du président français ne cesse d’être reporté. La France et l’Iran ont également traversé une crise diplomatique grave en 2018, conduisant la France à repousser de plusieurs mois la nomination de son nouvel ambassadeur à Téhéran.
A l’origine de cette crise, un attentat déjoué contre un meeting de l’Organisation des moudjahiddines du peuple iranien à Villepinte. Les moudjahiddines du peuple sont des opposants en exil au régime iranien, alliés de Saddam Hussein durant la guerre de 1980. Selon Denis Bauchard, ils ont la particularité d’être des « marxistes pro-américains ». « L’Iran a reconnu à demi-mot son implication dans ce projet d’attentat », me révèle Philippe Bonnecarrère. La relation franco-perse a donc été quelque peu empoisonnée par cette crise. « Il y a une multiplicité des lignes de fracture entre nos deux pays, c’est assez effrayant », se désole Bonnecarrère.
Cette hostilité américaine et européenne aurait pu constituer pour l’Iran une épine dans le pied, voire un coup d’arrêt à sa politique d’expansion. Cependant, Donald Trump a manifesté à plusieurs reprises son souhait de désengager les Etats-Unis du Moyen-Orient. En ce sens, il a annoncé un retrait progressif des troupes américaines d’Afghanistan, d’Irak et de Syrie. La nature a horreur du vide, la géopolitique aussi, et la finalisation du retrait américain laisserait les mains libres à l’Iran pour renforcer son influence dans ces pays. Le ralentissement économique lié aux sanctions contre le régime ne constituerait alors pour l’Iran qu’un léger contretemps dans son projet de domination du Moyen-Orient.
Conclusion :
Malgré quelques péripéties, l’arc chiite s’est rarement aussi bien porté. Pour l’Iran, la situation n’est peut-être pas aussi avantageuse qu’en juillet 2015, mais le rétablissement des sanctions ne devrait pas porter atteinte à son projet hégémonique. D’autant plus que la Russie, la Chine et l’Union européenne ont manifesté leur souhait de contourner ces sanctions.
Cependant, l’arc chiite pourrait être fragilisé non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. Le réveil du nationalisme irakien pourrait ainsi remettre en cause la mainmise iranienne sur ce pays. De plus, l’Iran a été le théâtre en 2017 et 2018 d’importantes manifestations, causant 25 morts et 8000 arrestations. L’un des slogans des manifestants enjoignait les responsables politiques à investir de l’argent en Iran, et non en Syrie. La population iranienne, touchée par le chômage et par la stagnation de l’économie, pourrait vite se lasser des aventures géopolitiques de son pays au Moyen-Orient. Mais selon Denis Bauchard, l’idée d’un retournement de la population persane contre son propre gouvernement reste de l’ordre de l’« illusion ».
« Le régime peut compter sur le soutien des classes moyennes et populaires. Celles-ci considèrent, avec une certaine forme de résignation, qu’il n’y a pas d’alternative crédible au régime islamique. Le peuple est également conscient du bilan globalement positif de la révolution iranienne par rapport au régime du shah ». Nul doute, l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient a de beaux jours devant elle.
A lire aussi :
Trump et l'Iran, la stratégie du fou
Gaullisme géopolitique et néo-conservatisme
La fabrication de l'ennemi
A lire aussi :
Trump et l'Iran, la stratégie du fou
Gaullisme géopolitique et néo-conservatisme
La fabrication de l'ennemi
Lucien Petit-Felici
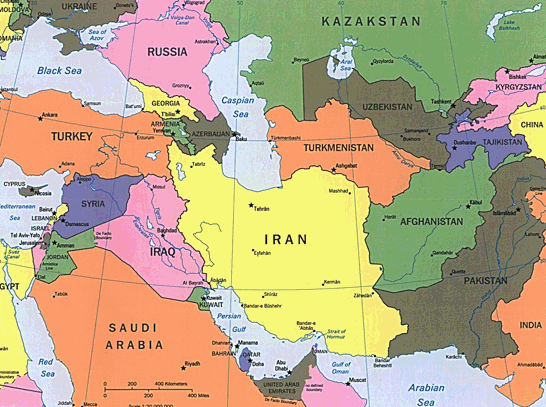












Commentaires
Enregistrer un commentaire